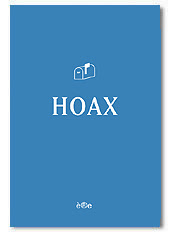Pour vaincre le chômage, abolissons le travail ! Telle est la devise de Frank Valberg, 30 ans, rentier de son état. Délaissant la servitude salariée pour la gestion optimisée de ses Sicav, ce faux oisif se défend d’être un parasite ou un marginal. Figure extrême du « temps choisi », il illustre à sa manière le changement radical des mentalités à l’égard de la valeur travail.
Il ne roule pas en Ferrari, ne se drogue pas à la coke, et n’a jamais mis les pieds dans une salle de marchés. D’un naturel réservé, allergique au culte de la performance, Frank Valberg n’a rien du golden boy. S’il devait choisir un modèle, nul doute qu’il préférerait Raymond Roussel (rentier dandy du début du siècle, tout entier dévoué à son œuvre littéraire), à Liliane Bettencourt, propriétaire de l’Oréal et première fortune de France avec un patrimoine estimé à plus de 65 milliards de francs.
Parcours gagnant
L’histoire commence à la fin des années 80 par une erreur d’aiguillage. Grâce à une composition réussie sur le thème : « Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? », Frank Valberg se retrouve admis à l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales. « A l’époque, se souvient-il, on nageait en plein bernard-tapisme : les winners d’un côté, les losers de l’autre. J’ai vite pris la tangente en m’inscrivant en licence de philo à la Sorbonne » ! A sa sortie de l’école, il refuse de devenir consultant, contrôleur de gestion ou chef de produit pour marchand de lessive, et intègre la fonction publique. « Moins par idéal, que par goût du confort », confesse-t-il. Il déchante vite en découvrant la bureaucratie, les petits chefs, les rivalités de chapelle et les frustrations d’un personnel sous-payé. Après huit mois de sacerdoce administratif, il remet sa démission et bénéficie d’une généreuse bourse octroyée par le groupe Carat : 280 000 F, officiellement destinés à financer pendant un an une étude sur « les enjeux de la compression numérique des images » (sic). L’ex agent contractuel se fait alors globe-trotter, mais pas pour autant cigale. Fin 92, Frank Valberg a 25 ans, de jolis tampons sur son passeport... et déjà 150 000 F d’économies personnelles.
La récession menace, et les marchés financiers entrent en hibernation. Les Sicav monétaires ayant fait leur temps, Frank se réfugie sur l’or : + 100% en 6 mois. Pris au jeu, il récidive et jette son dévolu sur les pays émergents : + 50% au cours du deuxième semestre 93. « Le problème, reconnaît-il en bon lecteur de Max Weber, c’est que l’accumulation primitive du capital oblige à certains sacrifices ». Pendant que son argent travaille, Frank se contente d’expédients pour subvenir à ses besoins : piges diverses, études ponctuelles, CDD en tous genres. Au grand dam de son entourage, et sous l’œil goguenard de ses anciens camarades de promotion, le diplômé bac+5 mène une vie de smicard. Lassé de ce régime spartiate, il revient à la « normalité » en mars 95, grâce à un poste de rédacteur en chef adjoint dans un magazine d’informations high-tech.
Assuré d’un salaire confortable, il repart à la pêche aux Sicav, et cède de nouveau à la tentation des métaux précieux (Orvalor : + 40% entre mai 95 et mai 96), puis des pays exotiques (Extentiel : + 50% entre mai 96 et juin 97). En juillet, les socialistes célèbrent l’arrivée de Jospin à Matignon. Frank Valberg, lui, fête ses trente ans et son premier million - quelques mois seulement après s’être fait licencié pour insuffisance professionnelle. « Mon employeur me reprochait de ne plus travailler assez, explique-t-il en riant. Mais quand vous êtes pressé comme un citron 50 heures par semaine, pour un salaire net à peine égal au tiers de vos revenus financiers, comment rester performant et motivé » ? Inscrit à l’ANPE, il fait semblant de chercher un emploi et vit en touchant les derniers dividendes de l’Etat providence. Pendant ce temps-là, le boursicotage continue : Frank prend part à la grande braderie France Télécom (privatisé à 50% de sa valeur), et après 8 mois d’euphorie boursière, liquide son portefeuille d’actions françaises pour un montant total supérieur à un million et demi. GAME OVER ! « La bulle financière ne devrait pas tarder à éclater, conclut-il doctement. Avec la crise asiatique, les marchés financiers sont au bord du gouffre. Ils plongeront à coup sûr, si les communistes chinois s’avisent de dévaluer le yuan. Dix ans après la chute du mur, la muraille de Chine fait désormais figure de digue pour le système capitaliste. Amusant, non ? ». L’an prochain, Frank Valberg devra verser plus de 100 000 F au fisc, au titre de l’impôt sur les plus-values. Selon toute vraisemblance, il s’en acquittera en liquidant le Plan Epargne Logement ouvert à sa naissance par ses parents. Ces derniers rêvaient d’un autre avenir pour leur progéniture : situation stable, emploi durable, domicile fixe acheté à crédit. Lui préfère la vie au comptant, le temps libre et les échappées belles au bout du monde. Problème de maturité sans doute...
Vous avez dit parasite ?
Pour quelques mois encore, Frank touche les Assedic - à peine de quoi payer son loyer et remplir son frigo. L’appoint - suffisant, vu le montant du capital placé - est assuré par ses revenus financiers. Accessoirement, il continue de travailler comme pigiste pour plusieurs lettres d’informations professionnelles. « Je ne suis pas contre le travail en tant que tel, précise-t-il. Je suis contre le salariat envisagé comme seul moyen d’accès à la reconnaissance sociale ». A la différence du rentier parasite qui se contente de maximiser son inutilité, sa démarche consiste à s’affranchir autant que possible de la contrainte du gagne-pain pour mieux se consacrer aux activités de son choix. « Je n’ai jamais été aussi actif que depuis que je suis sans emploi », ironise-t-il. Au lieu de sacrifier en vain à une quelconque « raison sociale » , il assume la diversité de ses centres d’intérêt, reste maître de son emploi du temps et ignore la frontière entre travail et loisir. Membre de plusieurs associations, il collabore également, de façon régulière et bénévole, à un nouveau journal - « Crash, le magazine de la génération numérique » - créé il y a un an par un groupe d’amis.
Reprenant à son compte les arguments développés par André Gorz dans son ouvrage « Misères du présent, richesse du possible », Frank récuse l’idée selon laquelle l’emploi - et plus précisément l’emploi salarié, stable, à temps plein - constitue la condition sine qua non de l’intégration et de l’accomplissement individuel. « Il suffit de regarder mes anciens camarades de l’ESSEC, devenus cadres supérieurs dans de grandes sociétés, pour se convaincre du contraire. Vus de l’extérieur, ils font figure de privilégiés, voire de modèles. Mais en réalité, la plupart d’entre eux éprouve le désir de « débrancher » pour bénéficier d’une meilleure qualité de vie, avec plus de temps libre et davantage de disponibilité pour leur vie personnelle. S’ils ne le font pas, c’est uniquement par crainte de se trouver marginalisés, exclus d’un système qui rejette les sans-emploi dans le néant ». Devenu rare, précaire, flexible, de plus en plus inégalitaire en termes d’horaires, de durée et de salaires, l’emploi n’est plus à même de remplir les fonctions structurantes qui lui étaient traditionnellement assignées. « Pourquoi donc continuer à le présenter comme un bien désirable ? A quoi bon souscrire encore aux équations simplistes : travail = dignité ; non emploi = déchéance ? ».
Anachronique ?
Abonné à « la crise » depuis sa naissance, Frank refuse de voir dans cette évolution une anomalie passagère. Pour lui, le modèle économique fondé sur le plein-emploi est révolu, et le primat du travail dans notre société définitivement dépassé. Comme le souligne Dominique Méda dans son essai : « Le travail, une valeur en voie de disparition », la situation actuelle « rappelle étrangement le siècle qui inaugura l’entrée dans la modernité, c’est-à-dire le moment où, sous la menace d’un nouvel ordre - celui auquel ouvrait le système héliocentrique -, toutes les forces traditionnelles se rassemblèrent pour faire obstacle à son émergence ». Aujourd’hui, c’est la position centrale du travail dans la galaxie économique que les tenants de l’ordre existant - pouvoirs publics, responsables économiques, représentants syndicaux - s’efforcent de sauver à tout prix. Plus que jamais, le travail est érigé en valeur cardinale : les pleureuses de « l’horreur économique » n’en finissent pas de regretter le bon vieux temps du travail pour tous. Les ayatollahs du capital multiplient les incantations pour obtenir toujours plus d’aides à la création d’emplois. Les responsables politiques entonnent à l’unisson le grand air de la lutte contre le chômage. Quant aux apôtres de la révolution numérique, ils prêchent à l’envi sur le thème : « Sachez tirer parti des nouvelles technologies, et le plein emploi sera de retour » ! Sur fond de télétravail, de commerce électronique et de retour en grâce de la petite entreprise, les cyber-yuppies s’imposent même comme la dernière secte à la mode. Pour couronner le tout, les gourous des sondages martèlent inlassablement que l'emploi constitue la préoccupation numéro 1 des Français. Comme si cette réalité reflétait autre chose que l'angoisse du gagne-pain !
Marginal ?
Loin de ce laborieux catéchisme, Frank Valberg revendique son hérésie. Et il est loin d’être le seul. En Grande-Bretagne, les « Idlers » (oisifs en anglais) affichent ouvertement leur dissidence vis à vis de la société du travail. Porte-parole de tous les réfractaires à la vie active, leur revue The Idler se livre, avec humour et intelligence, à un véritable travail de sape des valeurs productivistes. La démarche pourrait paraître anecdotique voire stérile, mais elle témoigne d’un vrai mouvement de fond, comme l’illustrent plusieurs études sociologiques concordantes, réalisées auprès de la fameuse Génération X décrite par David Coupland (« ceux qui refusent de mourir à 30 ans en attendant d’être enterrés à 70 »). David Cannon, auteur d’une enquête internationale sur l’attitude des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, relève ainsi que « la perspective d’une carrière dans un emploi à plein temps répugne à beaucoup. (...) Refusant de s’engager à plein temps et à long terme envers une firme, la Génération X ne se définit plus par son rapport à l’emploi. Ses membres ont un projet personnel qui compte davantage que les buts de l’organisation pour laquelle ils travaillent. (...) Ils sont de plus en plus prompts à mettre en question les buts et l’utilité du travail, ainsi que d’une société fondée sur le travail et cela au nom de leurs capacités, intérêts, valeurs et désirs d’individus qui ont une vie en dehors de leur travail et souvent se sentent en opposition avec lui » (source : Generation X and the New Work Ethic, Londres, 1994). En Allemagne, 10% seulement de la population active considèrent le travail comme ce qu’il y a de plus important dans la vie. Aux Etats-Unis, la proportion est de 18% contre 38% en 1955 (source : The Gallup monthly, septembre 91). Chez les Européens de l’Ouest âgés de 16 à 34 ans, le « travail » ou la « profession » viennent loin derrière 5 autres priorités dans la liste des choses « qui sont réellement importantes pour vous personnellement », à savoir : avoir des amis ; avoir assez de temps disponible ; être en bonne forme physique ; passer du temps en famille et avoir une vie sociale active (cité par Roger Sue, Temps et ordre social, 1994). Même les diplômés des Grandes Ecoles, à priori formatés pour s’intégrer au mieux dans la société du travail, affirment de plus en plus leur « désir de ne pas être broyés par la machine ». Forts de leurs diplômes, ils ne s’attachent à aucun employeur particulier, refusent de faire carrière, et envisagent souvent « l’entreprise comme un simple prestataire qui fournit le service du salaire » (source : Alain Lebaube, la mutation du travail, in Le Monde Initiatives, 11 mai 1994).
Modèle à suivre ?
On pourrait ainsi multiplier les exemples - le dernier ouvrage d’André Gorz en fourmille - qui attestent d’un changement profond des mentalités à l’égard de la valeur travail - changement dont les pouvoirs publics ne semblent toujours pas avoir pris la mesure. Pour l’instant, la seule réponse politique à la mutation en cours se résume au partage et à la réduction du temps de travail. D’autres pistes beaucoup plus ambitieuses ont pourtant été suggérées. La plus radicale d’entre elles consiste ni plus ni moins à déconnecter activité et salaire, en proposant à tout citoyen un revenu suffisant pour vivre, quelle que soit sa situation économique. Cette allocation universelle inconditionnelle, sorte de smic sans contrepartie de travail, serait un droit absolu et permettrait à tout individu de subvenir à ses besoins, sans être obligé de mendier un emploi. Rien n’empêcherait évidemment les bénéficiaires d’une telle allocation d’exercer en parallèle une ou plusieurs activités rémunérées. Mais cette démarche resterait facultative, soumise à l’appréciation de chacun. Comme le précise André Gorz, « l’allocation universelle d’un revenu suffisant ne doit pas être comprise comme une forme d’assistance, ni même de protection sociale, plaçant les individus dans la dépendance de l’Etat providence. (...) [Elle] doit donner aux individus et aux groupes des moyens accrus de se prendre en charge, des pouvoirs accrus sur leur vie et leurs conditions de vie. Elle doit non pas dispenser de tout travail mais au contraire rendre effectif le droit au travail : non pas au travail qu’on a parce qu’il vous est « donné » à faire, mais au travail concret qu’on fait sans avoir besoin d’être payé, sans que sa rentabilité, sa valeur d’échange aient besoin d’entrer en ligne de compte » .
Une telle « utopie » reviendrait de fait à étendre à l’ensemble de la population le privilège dont jouit aujourd’hui le « rentier du troisième type ». Sauf que ce dernier tire son revenu de base du rendement de son épargne, alors que le revenu social garanti serait pris en charge par la collectivité. Avec quels moyens de financement ? Les mêmes que ceux qui servent aujourd’hui à entretenir l’illusion du retour possible au plein emploi. En coma dépassé depuis des années, la société du travail ne survit artificiellement qu’à coup de milliards affectés au traitement social du chômage, sans oublier les aides, subventions et allégements fiscaux de tous ordres, de plus en plus coûteux, officiellement destinés à créer des emplois qui ne voient en fait jamais le jour. Par ailleurs, cette allocation universelle unique, d’un montant suffisamment élevé pour couvrir l’ensemble des dépenses de base de chaque individu (ce qui en fait bien plus qu’un simple revenu minimum d’existence, tel qu’il existe déjà aux Pays-Bas, au Danemark et bientôt en Allemagne), se substituerait au maquis des aides sociales actuellement en vigueur : allocations familiales, minima sociaux, bourses d’études, allocations logement, etc. Ce n’est pas un hasard si l’idée d’un revenu social garanti, à priori marquée par l’idéologie socialiste libertaire, est envisagée d’un bon œil par certains libéraux, pressés d’en finir avec les « archaïsmes de l’Etat providence ».
Le 28 juin 1995, à l’initiative de la revue du Mauss, était publié dans Le Monde un « appel à débat en vue d’instaurer une politique économique et sociale résolument novatrice ». Les 35 signataires, d’origine et d’obédience très diverses (économistes, sociologues, journalistes, philosophes, militants de mouvements associatifs), proposaient une première étape en direction de l’allocation universelle, sous la forme notamment d’une extension du RMI (généralisation à toute personne ne disposant pas d’un niveau minimum de ressources garanti, y compris les jeunes de moins de 25 ans, et possibilité de cumul avec des ressources complémentaires tirées du travail). Trois ans après, force est de constater que c’est la piste rigoureusement inverse qui semble privilégiée. Jugée déraisonnable, irréaliste, et économiquement non viable - comme jadis les congés payés, la retraite, la Sécurité Sociale, les 35 heures, etc. -, l’idée du revenu social garanti est passée à la trappe, au profit de la réhabilitation du... travail forcé. Légalisé fin juillet 96 par le président Clinton, le Workfare fait de plus en plus d’émules sur le vieux continent. Son principe est simple : il s’agit de subordonner le versement des allocations de base à l’exercice d’un travail « d’utilité sociale », pour le compte d’une municipalité ou d’une association homologuée. De plus en plus de chômeurs longue durée se voient ainsi menacés de perdre leurs indemnités, s’ils refusent de se plier à ces tâches « d’utilité publique ». Paré des meilleures intentions (réinsérer les plus démunis par le travail ; dépasser la logique de l’assistanat), et fidèle au bon sens populaire selon lequel il ne saurait y avoir de salaire sans travail, le Workfare revient de facto à stigmatiser les chômeurs comme des incapables ou des fainéants, que la société est fondée à contraindre au travail - pour leur plus grand bien évidemment ! A l’opposé de la logique de l’allocation universelle, cette nouvelle forme de STO (Service du Travail Obligatoire) réaffirme avec force le lien indéfectible qui doit unir rémunération et activité : Pas de statut social sans emploi, pas de revenu sans travail, et pas de reconnaissance sociale pour les activités non rémunérées. La lutte contre le chômage en vient ainsi à justifier les pratiques les plus douteuses : refus de voir l’homme remplacé par la machine, même pour des tâches serviles ou dangereuses ; restauration de la servitude domestique (les fameux emplois de proximité) ; mépris des activités bénévoles et des réseaux de solidarité, sommés d’intégrer la sphère marchande pour créer de « vrais » emplois ; condamnation des économies de troc et des systèmes d’échanges locaux, accusés de menacer l’existence des entrepreneurs dûment inscrits au registre du commerce.
Dans ce contexte, l’attitude d’un Frank Valberg apparaît plus que jamais à contre-courant. Pourtant, comme on l’a vu, elle illustre de manière symptomatique les mutations de la société actuelle, tant dans le domaine économique (importance croissante de l’économie virtuelle, fin du travail considéré comme source première de richesse) que dans le domaine culturel (aspiration des individus à toujours plus d’autonomie, divorce de plus en plus net entre l’emploi et la vie). Loin des clichés qui voudraient faire de lui un parasite, un marginal, ou tout simplement un habile petit boursicoteur, Frank Valberg revendique - et expérimente - un autre rapport à la vie active. Pour lui, la société du travail a vécu : mieux vaut en faire son deuil et tirer parti de l’espace ainsi ouvert, que s’acharner à en perpétuer le fantôme, comme le fait aujourd’hui la classe politique. Philosophe, Frank conseille à « nos dirigeants d’aller se faire voir chez les grecs », et de renouer avec la sagesse antique - celle qui valorise la pensée, la contemplation et la science en général, au détriment des activités soumises à la nécessité. Peut-être Lionel Jospin, en vacances à Antiparos, a-t-il suivi le conseil, et médité la sentence favorite de notre rentier : « La vie de loisir a en elle-même le plaisir et le bonheur de la vie bienheureuse. Mais cela n’appartient pas à ceux qui ont une vie laborieuse, mais à ceux qui ont une vie de loisir, car l’homme laborieux accomplit son labeur en vue de quelque fin qu’il ne possède pas, tandis que le bonheur est une fin qui ne s’accompagne pas de peine, mais de plaisir » (Aristote, La Politique, livre VIII, chapitre III).
Edité en septembre 1998